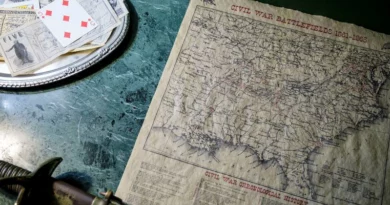Histoire de Napoléon : III. Un empereur et un conquérant
Désormais Empereur
Conscient des dangers qui le menacent, notamment après avoir échappé de justesse à un attentat, Napoléon Bonaparte aspire à consolider et à diffuser le modèle révolutionnaire français s’inspirant de l’idéal impérial. Le 2 décembre 1804, dans un geste symbolique et audacieux, il s’autoproclame Empereur dans la cathédrale Notre-Dame de Paris couronnant également Joséphine de Beauharnais comme Impératrice.


Ce geste assoit son autorité et envoie un message puissant au reste de l’Europe. Il est important de bien comprendre pourquoi Napoléon a tenu à devenir empereur : un empereur est au-dessus des rois et c’est bien cela qui est à retenir. Napoléon a toujours été un fervent défenseur des valeurs révolutionnaires et républicaines. Il a grandi dans un milieu plutôt modeste et cela a forgé son rapport à l’élitisme ambiant de son époque encore imprégné de l’Ancien Régime.


En devenant Empereur non seulement il montrait jusqu’où pouvait aller la promotion de la toute jeune république et aux autres royaumes ennemis :
« Je suis l’empereur, je suis au-dessus des rois ».
Peu après son couronnement, l’empereur organise une cérémonie importante pour les gardes nationales et les différents corps d’armée, leur remettant un nouveau drapeau et leur faisant prêter serment de fidélité.

SERMENT DE L’ARMÉE FAIT À L’EMPEREUR APRÈS LA DISTRIBUTION DES AIGLES, 5 DÉCEMBRE 1804. (Jacques-Louis DAVID)
De 1804 à 1814, on la surnomma la Grande Armée, Napoléon était énormément apprécié de ses hommes. Reconnu comme un brillant chef de guerre, il avait l’armée et même le peuple plus globalement derrière lui. Il a d’ailleurs été très peu sujet aux contestations populaires durant son règne et sans ce soutien indéfectible, il n’aurait pas pu mener à bien ses ambitions.


Cette ascension fulgurante n’est que le début d’une plus longue épopée, celle de la conquête de l’Europe par le nouvel empereur. Depuis son sacre en tant qu’Empereur, le 2 décembre 1804, il jouit à présent d’une aura comme aucun souverain n’en a connu. Cette renommée légitime ses actions, notamment militaires, qui vont lui faire conquérir quasiment toute l’Europe.

À la conquête de l’Europe
La troisième coalition
L’adversaire ancestral britannique reste une menace persistante. Ainsi Napoléon entraîne l’Espagne dans le conflit avec le Royaume-Uni, nécessitant la force navale espagnole. Une armée suffisante est amassée près de la Manche prête pour une invasion de la Grande-Bretagne. La France, soutenue par l’Espagne, s’engage dans le conflit avec le Royaume-Uni.

Napoléon dirige la flotte française en Méditerranée vers les Antilles, espérant attirer et détourner la Royal Navy, puis fait un retour brusque vers la Manche pour faciliter un débarquement militaire sur le sol britannique. Cependant, le retour est marqué par un échec, la flotte française est détectée et attaquée par le long des côtes espagnoles se retrouvant piégée à Cadix.

Pour Napoléon, empereur des Français et roi d’Italie, les plans doivent être révisés car le Royaume-Uni a réussi à former une nouvelle coalition avec la Russie et l’Autriche. L’Autriche déploie ses forces en Italie et en Bavière où elles doivent se joindre à l’armée russe. Napoléon, anticipant ses mouvements, propulse sa Grande Armée vers la Bavière dans l’objectif de devancer les Russes.

Il orchestre une manœuvre de diversion, en dirigeant un corps d’armée vers la forêt noire, un lieu où les Autrichiens l’attendent. Alors que la majorité des troupes françaises les contourne par le nord, les Autrichiens réalisent trop tard qu’ils sont encerclés. Cinq jours après 25 000 soldats autrichiens capitulent sans résister.

Pendant ce temps Napoléon commande à sa flotte immobilisée à Cadix de s’évader vers la Méditerranée. Les navires espagnols tentent de briser le blocus mais sont vaincus par la flotte britannique de l’amiral Nelson qui trouve la mort lors de cette confrontation. Cette bataille, connue sous le nom de bataille de Trafalgar, permet au Royaume-Uni d’affirmer sa domination maritime.

En Autriche, confrontée à l’armée française, l’armée russe se retire vers le nord-est pour se regrouper, ouvrant ainsi la voie vers Vienne. Napoléon prend possession de la capitale autrichienne y laissant une partie de ses troupes et se dirige avec le reste de son armée pour affronter les troupes du Tsar Alexandre Ier et les restes des forces de l’empereur François Ier d’Autriche.

Napoléon, bien que numériquement inférieur, déploie ses troupes sur le plateau de Pratson. Elaborant une stratégie dans la soirée du 1er décembre, il feint une retraite, attirant l’armée austro-russe sur le plateau. Le lendemain, alors que les Russes croient à une déroute française, les troupes de Napoléon, cachées derrière les collines, lancent une attaque surprise, reprenant le contrôle du plateau et divisant l’ennemi.

Malgré leurs efforts pour récupérer le terrain perdu, les forces de la coalition sont défaites. Les Français encerclent des milliers de soldats russes et les poussent à la fuite sur des étangs gelés où la glace cède sous les tirs d’artillerie causant de lourdes pertes. La célèbre victoire française à Austerlitz est décisive et entrera à jamais dans l’histoire militaire. Cette bataille est encore étudiée dans les écoles de guerre aujourd’hui.

L’empereur d’Autriche est forcé de négocier la paix par le traité de Presbourg, le 26 décembre 1805, entraînant la perte de territoires allemands et la dissolution du Saint-Empire romain germanique au profit de la confédération du Rhin sous l’égide de Napoléon. Il installe ses frères sur ses trônes européens consolidant ainsi son influence. En hommage à ses succès Napoléon initie la construction de l’Arc de Triomphe à Paris, un monument destiné à commémorer ses victoires jusqu’aux prochaines batailles.

La Quatrième coalition
La Prusse, mécontente de la gestion par la France des États allemands, se joint à d’autres nations pour initier la Quatrième coalition contre Napoléon. Trois armées prussiennes se déploient en Saxe et lancent un ultimatum aux français leur demandant de se retirer à l’ouest du Rhin. Napoléon avance avec sa Grande Armée et, dès les premiers affrontements, les forces françaises prennent l’ascendant repoussant les armées prussiennes en direction de Leipzig.
Cependant, l’armée française, se déplaçant rapidement, rattrape et s’infiltre entre les deux principales armées ennemies. Napoléon, sous-estimant la position de l’armée principale prussienne, envoie une petite troupe de 25 000 hommes au nord qui se retrouve face à une force prussienne de plus de 60 000 hommes. Malgré cet écart numérique, les Français remportent les combats de ce jour ouvrant la voie vers Berlin pour Napoléon.

Dans la campagne de Pologne, suite à la soumission de la Prusse, Napoléon dirige ses efforts contre la Russie, pénétrant dans l’ancienne Pologne divisée une décennie auparavant entre la Russie la Prusse et l’Autriche, les Français sont acclamés en libérateurs, ralliant des milliers de soldats locaux à leur cause.
À la bataille d’Eylau, les armées évitent d’abord l’affrontement, les Russes se repliant en attente de renforts. Lorsqu’ils se rencontrent, les deux jours de combat intenses qui s’en suivent sont d’une brutalité extrême entraînant de lourdes pertes des deux côtés. Plus tard à la bataille de Friedland, les Russes tentent une offensive surprise contre les Français à Heilsberg mais sont repoussés et poursuivis. La confrontation à Friedland s’avère décisive forçant les Russes à reculer au-delà du fleuve Niémen.

À l’issue de ces batailles, épuisées par le conflit, les deux puissances se retrouvent dans une impasse incapables de se dominer l’une l’autre. Suite à leurs affrontements, la France et la Russie mettent en scène la signature des traités de Tilsit en 1807. Cet événement historique a lieu sur un radeau spécialement conçu pour l’occasion sur le fleuve Niémen où Napoléon et le tzar Alexandre Ier concrétisent leur entente.

La Prusse se voit contrainte de céder la moitié de ces territoires, ceux à l’ouest étant annexés par le nouveau royaume de Westphalie avec à sa tête Jérôme Bonaparte, à l’est la création du Duché de Varsovie, allié à la France, constitue une base stratégique pour d’éventuelles confrontations futures. La Russie quant à elle obtient le feu vert pour s’approprier la Finlande. Dans un effort commun, la France et la Russie forment une alliance contre le Royaume-Uni, alors en situation précaire. Napoléon instaure un blocus continental, une mesure drastique qui interdit à tous les ports européens d’accueillir des navires marchands britanniques dans l’espoir de fragiliser l’économie britannique déjà mise à mal par des guerres coûteuses.
Cependant, certains pays, dont le Portugal, fidèle allié de la Grande-Bretagne, ne s’accordent pas avec cette politique.
La prise de Lisbonne
En réponse à la résistance du Portugal face au blocus continental, Napoléon décide d’envahir ce pays. l’Espagne, alliée de la France, permet le passage des troupes françaises aboutissant à la prise de Lisbonne et à la fuite de la famille royale portugaise vers le Brésil. Cet événement marque l’envoi des renforts français en Espagne où Napoléon envisage désormais une expansion de son influence malgré la dégradation de la puissance espagnole.

Suite à un coup d’État avorté de Ferdinand contre son père le roi Charles IV d’Espagne, les deux se rendent à Bayonne pour solliciter l’intervention de Napoléon. Pendant ce temps à Madrid, une insurrection éclate contre l’occupation française et elle est brutalement réprimée. Napoléon installe alors son frère Joseph Bonaparte sur le trône espagnol tandis que son beau-frère Murat reçoit le royaume de Naples.

Cette influence de Napoléon sur le continent européen est une véritable histoire de famille, quasiment à son apogée, l’Empire napoléonien s’étend sur un vaste domaine de 130 départements et inclut le royaume d’Italie couvrant plus de 2 millions de kilomètres carrés. Les membres de sa fratrie ont été soigneusement placé à des positions de pouvoir. Joseph a été couronné d’abord roi de Naples avant de devenir roi d’Espagne tandis que Louis auparavant son assistant militaire, a été investi roi de Hollande. Jérôme a reçu le trône de Westphalie. Concernant ses sœurs : Elisa a été nommée duchesse de Toscane tandis que Caroline a été proclamée reine de Naples.
Mais revenons à nos batailles, la population espagnole, révoltée par la répression française, se lance dans une guérilla acharnée contre les occupants. Les Français, ciblant les zones de résistance, mène des représailles sévères. Pourtant la guérilla persiste. Dans le sud de l’Espagne, une armée française est vaincue, créant un élan pour les mouvements anti-français à travers l’Europe et permettant aux forces britanniques de débarquer au Portugal.
Napoléon, déterminé à résoudre personnellement la situation, dirige une partie de sa Grande Armée vers la péninsule ibérique. Lors d’une rencontre à Erfurt avec le tzar Alexandre, ils cherchent à consolider leur alliance sans succès. Malgré leurs victoires initiales, la Grande Armée rencontre des difficultés face à la résistance acharnée des armées espagnoles et autrichiennes.
La cinquième coalition
Une nouvelle coalition se forme contre Napoléon : la cinquième. L’Autriche, presque isolée, subit une rapide défaite et Vienne est prise une seconde fois. Les forces autrichiennes se replient au nord du Danube où elles sont confrontées à la Grande Armée de Napoléon.
Une bataille de cette époque a eu une importance particulière, celle d’Essling, elle survient le 21 et 22 mai 1809 et est un affrontement crucial dans l’histoire des guerres napoléoniennes marqué par son intensité et ses conséquences stratégiques significatives. Essling, considérée comme la première guerre d’usure sur deux fronts bloqués, a vu une utilisation massive de l’artillerie, une tactique qui deviendra caractéristique des combats de la Première Guerre mondiale.

Rentrons dans les détails de cette bataille. Face à la triple offensive de l’archiduc Charles d’Autriche, Napoléon orchestre une riposte fulgurante, fonçant vers Vienne pour un duel stratégique sur le Danube. La bataille des Essling déclenchée par la traversée audacieuse du Danube par les Français, se mue en un affrontement féroce et logistiquement complexe.
Les Autrichiens, défient les ponts précaires des Français avec une résistance implacable, exploitant leur supériorité numérique dans des combats acharnés. Cette confrontation intense voit le valeureux maréchal Jean Lannes, fidèle de Napoléon, tomber au champ d’honneur, un coup dur symbolique pour l’empereur et sa campagne. La disparition de Lannes affecte profondément le moral et la stratégie de l’armée française, et cela incarne l’avènement de la guerre totale, marqué par une artillerie dévastatrice et des combats urbains brutaux.
Les lourdes pertes françaises témoignent de l’intensité et de la violence de cette bataille, un précurseur des conflits futurs plus sanglants et complexes. Essling marque un tournant crucial dans les guerres napoléoniennes illustrant une évolution vers des affrontements plus impitoyables et élaborés.
Un autre combat épique encore, après la construction de pont et une traversée risquée, est la bataille de Wagram, elle voit plus de 140 000 soldats français combattre les autrichiens qui finissent par demander l’armistice, menant au traité de Schönbrunn en 1809. Le traité impose à l’Autriche la cession de vastes territoires et limite son accès à la mer.
A cette même période, Napoléon, faute d’héritier légitime avec Joséphine, divorce et épouse Marie-Louise, fille de l’empereur d’Autriche, donnant naissance à l’héritier tant attendu, Napoléon François Joseph Charles, qui sera connu sous le nom de roi de Rome ou encore l’Aiglon. Pendant ce temps les coûts économiques et humains de la campagne d’Espagne pèsent lourdement sur la France.

En 1812, le Royaume-Uni intensifie son intervention militaire dans la péninsule ibérique en déployant une nouvelle force sous le commandement de Wellington, qui débarque au Portugal et surpasse les troupes françaises sur place. Ces dernières, requérant des effort auprès de Napoléon, se retrouvent néanmoins délaissées, l’Empereur ayant détourné son attention et ses ressources militaires vers le Duché de Varsovie.
Les tensions entre la France et la Russie s’enveniment menant Napoléon à lancer une invasion du territoire russe. Cette campagne russe se révèle être l’événement le plus désastreux de l’ère napoléonienne entraînant l’épuisement des troupes de la Grande Armée et marquant le commencement d’une période de déclin pour l’Empire français.